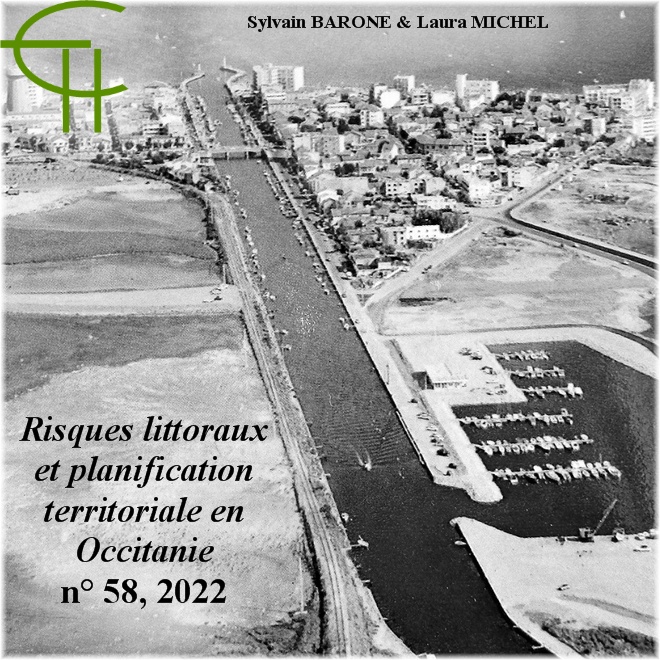€2.00
Description
Risques littoraux et planification territoriale en Occitanie
* Chercheur en sciences politiques à l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE) il est membre de l’UMR G-EAU. Ses recherches portent sur la mise en œuvre et les re-compositions de l’action publique en matière d’environnement et de changement climatique. Les politiques de l’eau, d’adaptation aux risques littoraux, le portage socio-politique des questions climatiques aux échelles locales et le traitement pénal des atteintes à la nature, sur des terrains majoritairement français sont au cœur de ses analyses.
** Maîtresse de conférences en science politique à l’Université de Montpellier, elle est membre de l’UMR CEPEL, laboratoire rattaché au CNRS. Ses recherches portent sur le gouvernement de la critique environnementale. Elle mène actuellement des travaux sur la démocratie environnementale, l’écologisation des politiques agricoles et alimentaires locales et les politiques d’adaptation aux risques littoraux.
p. 127 à 138
Depuis la création du Conservatoire du Littoral (1975) et la prise en compte par l’État du changement climatique, les risques littoraux sont appréhendés différemment, selon qu’ils sont considérés comme des « risques naturels » imprévisibles ou comme les résultats d’une évolution progressive et donc anticipable. Il en résulte une complexité de l’action publique dans la gestion du littoral, que l’article analyse au travers des interactions entre catégories d’acteurs (État, élus locaux et territoriaux, experts scientifiques, populations locales…). Est également abordée la multiplicité des outils réglementaires et de planification, illustrée par la situation de quelques communes de la côte languedocienne.
Since the creation of the Conservatoire du Littoral (1975) and the government’s stance on climate change, coastal risks have been approached differently, depending on whether they are considered as unpredictable « natural risks » or as the results of a gradual and therefore expectant evolution. The result is a ramification of complex public action in coastal management, which this article analyses showing interaction between categories of stakeholder groups (central government, local and territorial elected officials, scientific experts, local populations, etc.). The multiplicity of regulatory and planning tools, shown by the situation of some municipalities on the Languedoc coast, is also discussed
La question des risques littoraux n’émerge vraiment que plusieurs décennies après la période de forte anthropisation du littoral français, et notamment celle favorisée par la Mission Racine dans le Golfe du Lion, mission interministérielle d’aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon. Dans les années 1970, cette urbanisation littorale massive – notamment sur la Côte d’Azur – est pointée du doigt par le rapport Piquard (1973), qui évoque une privatisation de cet espace au profit de quelques-uns, et la nécessité de le préserver d’une urbanisation trop intensive. Une première réponse est apportée en 1975 avec la création du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, chargé d’acquérir du foncier pour le soustraire à l’artificialisation. Une dizaine d’années plus tard, la loi Littoral de 1986 limite l’urbanisation en bordure littorale. Les risques littoraux ne font cependant pas alors réellement partie des préoccupations du législateur.
Les risques dits naturels acquièrent dans les années 1980 un statut de problème public suite à une série de catastrophes, et font l’objet de législations spécifiques : la loi de 1982 impose ainsi des plans d’exposition aux risques ; la loi Barnier de 1995 introduit la notion de « risques naturels majeurs » et prévoit – dans la suite des inondations meurtrières de Vaison-la-Romaine en 1992 – un fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit Fonds Barnier). Les risques de submersion marine ne sont toutefois toujours pas identifiés en tant que tels, contrairement aux débordements de cours d’eau. La problématique de l’érosion côtière, elle, n’est prise en charge au-delà d’une échelle très locale qu’à partir des années 1990. Les ouvrages de protection en enrochement (digues, épis, brise-lames), dont les transferts d’érosion sont désormais connus, sont progressivement remis en cause au profit de techniques réputées moins im-pactantes : rechargement des plages en sable, ingénierie écologique pour la reconstitution de cordons dunaires… Les orientations stratégiques pour la gestion de l’érosion en Languedoc-Roussillon publiées en 2003 par la Mission interministérielle d’aménagement du littoral s’inscrivent parfaitement dans cette tendance. […]
Informations complémentaires
| Année de publication | 2022 |
|---|---|
| Nombre de pages | 12 |
| Auteur(s) | Michel LAURA, Sylvain BARONE |
| Disponibilité | Produit téléchargeable au format pdf |