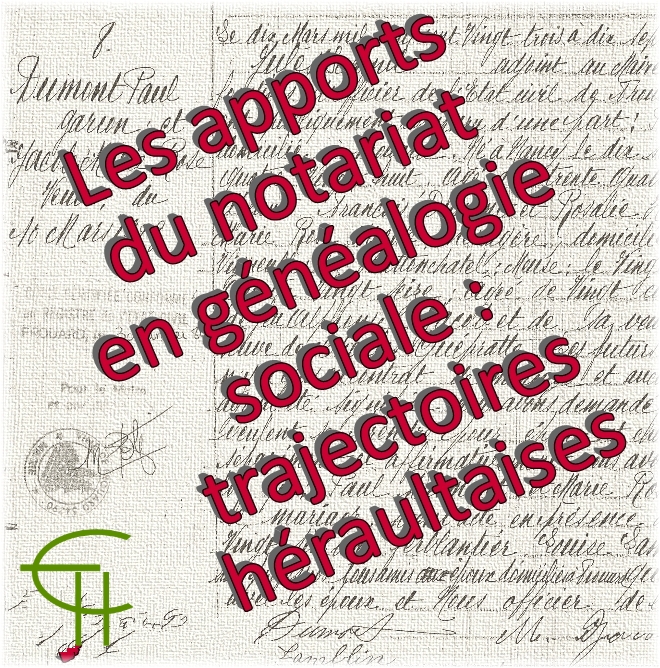Description
Les apports du notariat en généalogie sociale : trajectoires héraultaises
La généalogie sociale, autrement dit, l’inscription de l’histoire des familles dans l’évolution de la conjoncture économique et sociale, est actuellement un secteur de recherche en plein développement, comme en témoignent divers travaux récents, parmi lesquels ceux de Jacques Dupâquier, d’Adeline Daumard, d’Elie Pélaquier ou de Guy Brunet ainsi que certaines publications des Annales ESC (principalement en 1972), et des Annales de démographie historique (plus particulièrement en 1984).
La thèse que j’ai soutenue le 2 avril 2004, devant le jury de l’Université Paul-Valéry III, intitulée Trajectoires familiales et professionnelles, contribution à l’histoire économique et sociale du Languedoc, (XVIe-XXe siècles), se propose de contribuer à cette problématique, à l’essor récent, mais prometteur.
La mise en relation de trajectoires familiales et professionnelles, avec l’évolution de la conjoncture économique et sociale du Languedoc du XVe siècle à nos jours, celle de l’Hérault en particulier, fait en effet, l’objet de cette recherche.
Les Bessier sont, du fait de leur intéressant parcours, la principale famille servant de fil conducteur. D’abord gens de métiers : potiers de terre et fontainiers à Saint-Jean-de-Fos, au siècle de la Renaissance, chirurgiens et apothicaires dans les vallées de l’Hérault et de la Buège, sous Louis XIV, et encore au XVIIIe siècle, facturiers en coton à Montpellier de 1760 à 1840, à la grande époque de l’indiennage, ils connaissent au XIXe siècle, au temps des bourgeois conquérants, une fulgurante ascension. Elle a pour cadre la petite ville de Mèze, sur les rives de l’étang de Thau, et passe par deux voies : le tissu (plusieurs générations de marchands de nouveautés), et surtout la vigne, en cet âge d’or du vignoble languedocien ; ils en subissent les vicissitudes et s’orientent vers les activités liées à l’exploitation du littoral.
Ils ne sont pas des cas isolés, mais sont, de génération en génération, représentatifs de l’évolution de la société languedocienne.
Loin d’être le fait du hasard, les adaptations successives des familles ici reconstituées, sont révélatrices des stratégies d’un Languedoc qui, d’âge en âge, au travers d’essais parfoisinfructueux, est à la recherche de sa voie.
La généalogie sociale nécessite le recours à toutes les sources possibles et imaginables sur l’histoire des familles. Elles sont nombreuses et bien connues. Si l’Etat civil (les registres paroissiaux de l’Ancien Régime), est indiscutablement le point de départ et le fondement de toute recherche généalogique, les sources notariales – abondamment utilisées tout au long de cette recherche – sont seules susceptibles de donner à une monographie familiale, son épaisseur sociale. Elles permettent en particulier une évaluation très précise des niveaux de fortune. […]
Informations complémentaires
| Année de publication | 2005 |
|---|---|
| Nombre de pages | 12 |
| Auteur(s) | Didier PORCER |
| Disponibilité | Produit téléchargeable au format pdf |