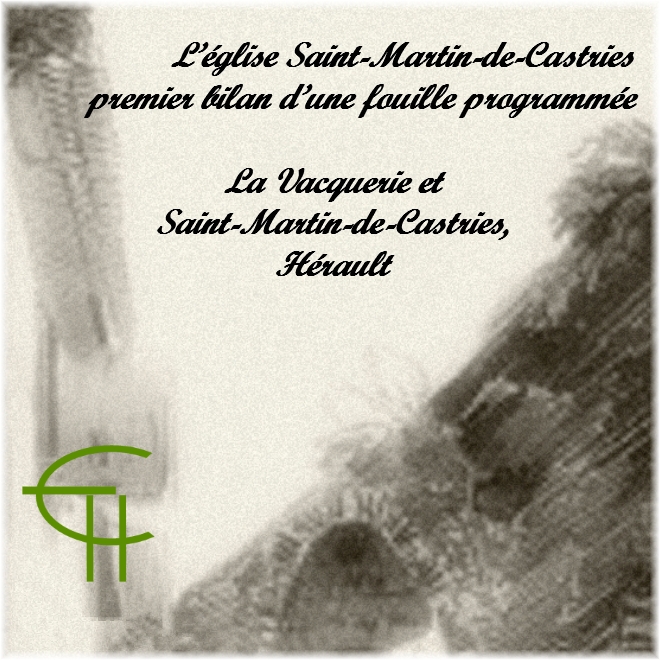Description
L’église Saint-Martin-de-Castries : premier bilan d’une fouille programmée
(La Vacquerie et Saint-Martin-de-Castries, Hérault)
La volonté d’intégrer dans un circuit de découverte du Larzac lodévois, l’église romane Saint-Martin-de-Castries est à l’origine de plusieurs campagnes archéologiques. La restauration de l’édifice, confiée à F. Fiore, architecte DPLG (Fiore 2002), a été précédée en 2001 d’une campagne de sauvetage afin de déterminer quel sol intérieur, le plus représentatif de l’histoire de l’église, pouvait être présenté au public (Bergeret, Guillot 2001). La richesse et la complexité du site alors mises en évidence ont motivé l’engagement d’une étude, dans le cadre d’une fouille programmée, qui s’est déroulée de 2002 à 2005 (Bergeret 2004b). En 2006, une année supplémentaire va permettre de compléter le dossier, elle sera la dernière d’une série de six campagnes.
L’objectif de cette recherche est de cerner l’évolution d’un pôle ecclésial et sa dynamique de mise en place du haut Moyen Âge jusqu’à son abandon au début de l’époque contemporaine. De plus, la fouille d’une partie du cimetière, et d’un échantillon significatif de sépultures, à pour but d’apporter des informations à la fois sur les pratiques funéraires et sur la population inhumée.
La nécessité d’une diffusion, sous la forme d’un premier bilan, avant la clôture des recherches de terrain, semblait s’imposer, au vue des découvertes et des engagements d’un nombre important de chercheurs : F. Dieulafait (Université de Toulouse) : étude numismatique ; R. Donat (anthropologue) : étude anthropobiologique ; V. Forest (INRAP, archéozoologue) : étude de la faune ; G. Guionova (LAMM, UMR 6572 Université de Provence – CNRS) : étude de la céramique, G. Mallet (Université de Montpellier) : étude lapidaire et A. Riols (Conseil Général de l’Hérault) : étude du verre. Ce travail pluridisciplinaire permettra de poser des bases solides et inédites, dans ce secteur peu connu de l’Hérault.
Cet article aborde, à travers des données archéologiques, les tout premiers siècles d’occupation du site de Saint-Martin-de-Castries, qui voit à un habitat rural alto médiéval, occupé sur un laps de temps relativement court, se superposer une église préromane et son enclos. Sont également présentées les données anthropologiques, en particulier la pathologie osseuse, relevées sur les sujets inhumés à la période préromane. Enfin, l’étude de la céramique dresse un bilan morphochronologique du mobilier.
Les sources historiques
Les données textuelles susceptibles d’enrichir notre connaissance du site de Saint-Martin-de-Castries ont été réalisées à des périodes et à des fins diverses. Les premiers éléments, d’époque médiévale, se rattachent à l’abbaye Saint-Guilhem-le-Désert dont dépend l’église de Saint-Martin. Ils correspondent essentiellement à des inventaires du patrimoine gellonien. Les seconds, d’époque moderne, se concentrent sur l’état matériel de l’église et ses dépendances : ce sont les comptes-rendus de visites épiscopales.
Des sources médiévales une seule donnée est certaine, le rattachement de l’église Saint-Martin-de-Castries à l’abbaye Saint-Guilhem-le-Désert qui en avait fait un prieuré cure. De la date de création de l’église et de celle de son rattachement à l’abbaye, rien n’est mentionné. En effet, un nombre important d’actes, présents dans le cartulaire de l’abbaye Saint-Guilhem-le-Désert, sont en réalité des faux, écrits dans le contexte de la querelle qui a opposé l’abbaye d’Aniane à celle de Gellone au cours des XIe s. et XIIe s. (Tissiet 1933/1992 ; Chastang 2005). […]
Informations complémentaires
| Année de publication | 2006 |
|---|---|
| Nombre de pages | 15 |
| Auteur(s) | Agnès BERGERET, Guergana GUIONOVA, Richard DONAT |
| Disponibilité | Produit téléchargeable au format pdf |