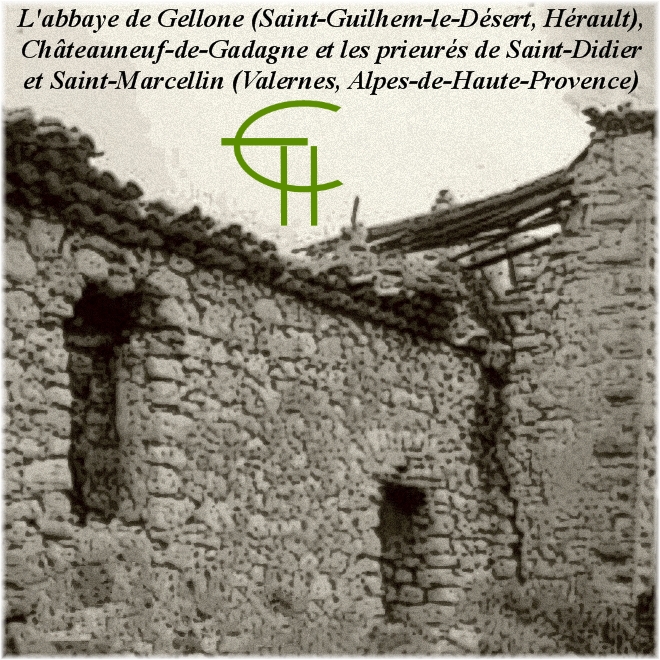Description
L'abbaye de Gellone (Saint-Guilhem-le-Désert, Hérault),
Châteauneuf-de-Gadagne et les prieurés de Saint-Didier et Saint-Marcellin
(Valernes, Alpes-de-Haute-Provence)
* Professeur d’Études romanes, Department of Romance Studies,
Morrill Hall, Cornell University, Ithaca, NY 14853-4701, USA.
Selon une tradition ancienne, Guillaume d’Orange, le futur saint Guillaume, enleva Châteauneuf-de-Gadagne aux Sarrasins et le donna en fief à l’abbaye de Gellone, qu’il avait fondée. Néanmoins, en dépit de cette tradition et en dépit de tous les engagements pris dans les chartes qui sont arrivées jusqu’à nous, l’abbé et la communauté de Saint-Guilhem-le-Désert finirent par aliéner le fief de Châteauneuf en le donnant à leur propre suzerain, le pape Jean XXII. Par une bulle du 1er décembre 1323, ce pontife transféra au Comtat Venaissin et à l’Église romaine cette seigneurie et tous les droits, juridictions et biens que l’abbé Raimond de Sérignac et son monastère y avaient et promit à l’abbé et au monastère la compensation qui leur était due en échange. Au dire de leur procureur, ils voulaient se débarrasser de Châteauneuf parce qu’ils en tiraient peu de profit, vu l’éloignement de ce village.
D’après ce que nous savons sur la redevance féodale que le seigneur de Châteauneuf devait à l’abbé, Raimond V et ses moines n’eurent pas tort de demander cet échange de biens au pape Jean XXII. Même s’ils acceptaient la tradition selon laquelle Guillaume avait offert le domaine de Châteauneuf à l’abbaye, ils ne se seraient pas sentis obligés de conserver ce fief, puisqu’ils croyaient que Guillaume leur avait donné un grand nombre de terres en Languedoc. Il n’est pas impossible, cependant, qu’ils aient agi de connivence avec le pape, qui avait tout intérêt à s’emparer de cette seigneurie enclavée dans le Comtat.
Par une bulle du 24 août 1345, le pape Clément VI tint la promesse faite par Jean XXII en donnant à l’abbaye de Saint-Guilhem les prieurés de Saint-Didier et Saint-Marcellin en échange de Châteauneuf. Ces prieurés se situaient à Valernes au nord de Sisteron, aux lieux-dits « château Saint-Didier » et « les Monges », nom occitan qui signifie « les Moines ». D’après le résumé de cette bulle dans le grand inventaire des archives de l’abbaye dressé en 1783, le monastère avait cédé à Jean XXII « son droit de censive annuelle d’une vache de diverses couleurs » et « tout droit de directe sur le Château-neuf du Pape, au diocése de Cavaillon, que Giraud l’Ami, chevalier, tenait en fief dudit monastére ». Il s’agit ici de Giraud VI Amic, seigneur de Châteauneuf, et de la redevance annuelle d’une vache-caille, c’est-à-dire d’une vache pie, qu’il fallait donner à l’abbaye le 28 mai, jour de la fête de saint Guillaume. […]
Informations complémentaires
| Année de publication | 2005 |
|---|---|
| Nombre de pages | 5 |
| Auteur(s) | Alice Mary COLBY-HALL |
| Disponibilité | Produit téléchargeable au format pdf |